Secteurs & marchés
L'électricité en ASEAN : entre monopoles nationaux et ambitions régionales vertes
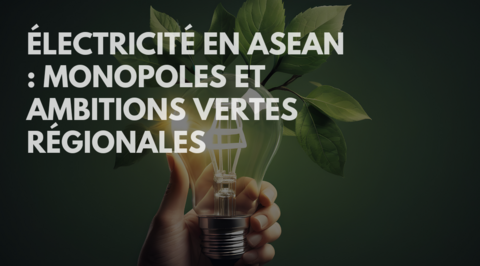
L’électricité en Asie du Sud-Est se caractérise par une diversité de modèles de régulation, allant de monopoles étatiques stricts à des marchés partiellement ou totalement libéralisés. Cette hétérogénéité reflète des réalités économiques, sociales et politiques variées, mais aussi des priorités nationales distinctes en matière de souveraineté énergétique, d’attractivité des investissements et de transition écologique.
Dans des pays comme le Vietnam, l’Indonésie ou le Laos, le secteur reste largement dominé par des acteurs publics. Electricity of Vietnam (EVN) et Perusahaan Listrik Negara (PLN) en Indonésie contrôlent l’essentiel de la production, du transport et de la distribution. Le Laos, surnommé « la batterie de l’ASEAN », mise sur l’hydroélectricité, majoritairement destinée à l’exportation, via des partenariats public-privé, bien que son réseau domestique reste fragile et peu interconnecté.
À l’autre extrême, Singapour et les Philippines ont opté pour une libéralisation poussée. Singapour permet une concurrence dans la production et la fourniture, tandis que le transport et la distribution restent aux mains du public SP Group. Aux Philippines, la loi EPIRA de 2001 a ouvert le marché à la concurrence et confié la gestion du réseau à un opérateur privé, la National Grid Corporation of the Philippines (NGCP).
Entre ces deux pôles, des pays comme la Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge ont engagé des réformes graduelles. La Malaisie, via sa feuille de route NETR, vise 70 % d’énergies renouvelables d’ici 2050 et développe des mécanismes de marché innovants comme les Corporate Green Power Programs. Le Cambodge, bien que très dépendant de l’hydroélectricité, encourage les producteurs indépendants (IPP) et vise 70 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2030.
Cependant, malgré des objectifs ambitieux comme ceux du plan APAEC de l’ASEAN qui prévoit 23 % d’énergies renouvelables dans le mix régional d’ici 2025, la réalité reste contrastée. Les énergies renouvelables intermittentes, comme le solaire et l’éolien, peinent à se déployer en raison de réseaux vieillissants, de tarifs non compétitifs et de cadres réglementaires parfois opaques.
Des initiatives concrètes, comme le Laos-Thailand-Malaysia-Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP), montrent la voie. Singapour, en particulier, mise sur les importations d’électricité verte pour atteindre ses objectifs climatiques.
Néanmoins, les obstacles restent nombreux : divergences réglementaires, investissements colossaux, enjeux géopolitiques et limites techniques. La priorité donnée à la sécurité énergétique nationale et la faible interconnectivité des réseaux domestiques freinent la réalisation d’un marché régional intégré.
Malgré tout, la dynamique est lancée. Les réformes structurelles, les mécanismes de financement innovants et la coopération régionale ouvrent la voie à une transformation profonde du paysage électrique sud-est asiatique. Les entreprises françaises, fortes de leur expertise en infrastructures et en énergies renouvelables, ont un rôle clé à jouer dans cette transition.
Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique


